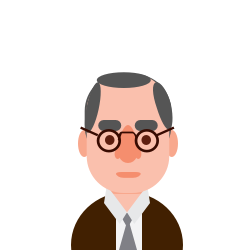
Voici Lévi-Strauss
(1908-2009) Est un anthropologue et ethnologue français. Son œuvre est construite autour de l'idée de la plurivocité des cultures humaines.
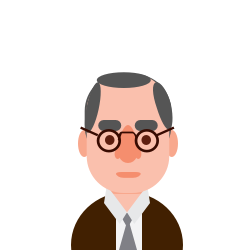
(1908-2009) Est un anthropologue et ethnologue français. Son œuvre est construite autour de l'idée de la plurivocité des cultures humaines.
L’inconscient symbolique, créateur des mythes fondateurs : Toutes les formes de socialisation dépendent d’une structure universelle inconsciente à partir de laquelle s’élaborent les grands mythes et les symboliques propres à chaque culture. Le subconscient est défini ici comme la manière propre à chaque individu de s’approprier ces mythes et ces symboles.
Dans les quatre volumes des Mythologiques, puis dans La Potière jalouse, Lévi-Strauss réfléchit à la signification des mythes, tout en interrogeant la nature de la signification : est-elle interne au mythe ou au mot, ou est-elle relative à la situation du mythe ou du mot au sein du système dans lequel il s’inscrit ?
Comment articuler les phénomènes culturels et naturels ? L’anthropologue et philosophe Claude Lévi-Strauss s’intéresse à la manière dont la culture prend le relais de la sélection naturelle pour constituer un niveau spécifique de détermination.
La parenté, la filiation ou les relations matrimoniales se situent à L’intersection – délicate à saisir – de la nature et de la société. Lévi-Strauss montre comment la prohibition de L’inceste bouscule les propriétés habituellement attribuées à la nature, d’une part, et à la règle, d’autre part.
Dans le premier chapitre de La Pensée sauvage, consacré à la « science du concret », Lévi-Strauss, refusant de distinguer absolument pensée rationnelle et pensée dite « primitive », soutient que les classifications des espèces opérées par les peuples dits « primitifs » supposent les mêmes opérations mentales que celles de la science moderne. Quelle est alors la différence entre pensée primitive et pensée scientifique moderne ?
Le premier chapitre de La Pensée sauvage est intitulé « La science du concret ». Claude Lévi-Strauss repère, dans la pensée des sociétés dites primitives, parfois réduite à L’irrationalité, une méthode rationnelle de cartographie du monde, différente du raisonnement de la science moderne, mais non moins digne. Afin de saisir la distinction entre la science du concret et la science moderne, L’anthropologue propose une analogie entre la pensée sauvage et le bricolage.
Lévi-Strauss discute deux opinions : d’une part, les techniques caractérisant les sociétés réputées « premières » seraient qualitativement inférieures aux techniques des sociétés dites « avancées » ; d’autre part, L’accumulation heureuse d’un capital technique dans une société serait propre à une seule culture : la nôtre. Dans quelle mesure s’agit-il d’opinions préconçues ?
Il est faux de dire que certaines civilisations sont moins avancées que d’autres.