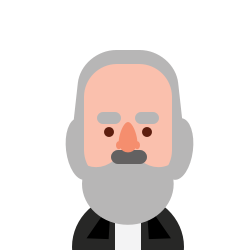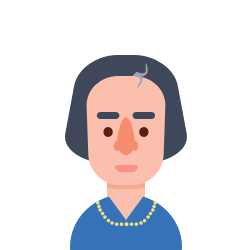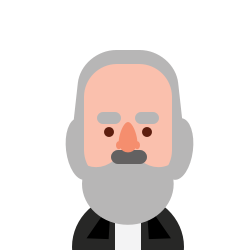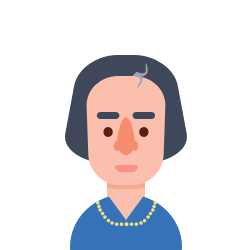# 1. **Explication du sujet** :
La question de savoir si l'on peut mesurer la valeur du travail soulève la problématique de la quantification de l'activité humaine et de sa contribution à la société. Elle interroge la notion de valeur, qui peut être économique, morale, ou personnelle, et la manière dont le travail est apprécié et évalué.
- Exemple 1 : **Adam Smith**, dans "La Richesse des Nations", considère le travail comme la mesure de la valeur. Il introduit la notion de travail comme étalon de valeur, où la quantité de travail nécessaire pour produire un bien détermine sa valeur d'échange.
- Exemple 2 : **Karl Marx** critique cette vision en introduisant la distinction entre travail concret et travail abstrait. Pour lui, la valeur d'un travail ne peut être réduite à son temps ou à son rendement économique, car cela néglige la dimension qualitative et aliénante du travail dans le capitalisme.
- Exemple 3 : **Aristote**, dans "Éthique à Nicomaque", aborde la valeur du travail sous l'angle de la finalité, où le travail vise un bien, qui est soit un produit utile soit une action vertueuse. La valeur n'est donc pas seulement mesurable en termes quantitatifs mais aussi qualitatifs.
- Exemple 4 : **Hannah Arendt**, dans "La Condition de l'homme moderne", distingue le travail de l'uvre et de l'action. Elle met en lumière la difficulté de mesurer la valeur du travail dans une société où le travail est souvent répétitif et sans fin, contrairement à l'uvre qui a une durabilité et une valeur intrinsèque.
La valeur du travail est donc une notion complexe qui dépasse la simple mesure quantitative. Elle implique des considérations économiques, sociales, éthiques et personnelles qui varient selon les contextes historiques et culturels. La mesure de la valeur du travail doit tenir compte de ces multiples dimensions pour être pleinement comprise.
# 2. **Du sujet à la problématique** :
Pour passer du sujet à la problématique, il est essentiel de suivre une démarche analytique qui décompose le sujet en ses éléments constitutifs pour en extraire une question centrale qui orientera la réflexion. Voici les étapes :
- **Identification des mots-clés** : Cela implique de repérer les termes principaux autour desquels le sujet s'articule.
- **Définition des termes** : Chaque mot-clé est défini pour clarifier son sens et sa portée dans le contexte du sujet.
- **Analyse conceptuelle** : Les termes sont mis en relation pour comprendre les implications et les présupposés qu'ils véhiculent.
- **Formulation de la question implicite** : À partir de cette analyse, on formule une question ouverte qui traduit le problème philosophique sous-jacent au sujet.
**Mots-clés et définitions** :
- **Peut-on** : Cette expression interroge la capacité ou la possibilité d'accomplir une action ou d'atteindre un état donné.
- **Mesurer** : Évaluer ou quantifier une grandeur, une qualité, ou une valeur à l'aide d'une échelle de mesure ou de critères spécifiques.
- **Valeur** : Importance, mérite ou utilité de quelque chose, qui peut être morale, économique, sociale, etc.
- **Travail** : Activité humaine visant la production de biens ou de services, souvent associée à la notion d'effort et de rémunération.
**Conclusion partielle sur la question implicite posée par le sujet** :
La question implicite qui se dégage du sujet est : "Quels sont les critères qui permettent de déterminer la valeur du travail, et est-il possible de les quantifier de manière objective ?" Ce sujet mobilise le repère **valeur/utilité** du programme de philosophie, car il interroge la nature de la valeur attribuée au travail, qui peut être considérée soit en termes d'utilité sociale et économique (valeur extrinsèque), soit en termes de réalisation personnelle et d'épanouissement (valeur intrinsèque).
# 3. **La problématique** :
Le travail a-t-il une valeur intrinsèque qui peut être objectivement mesurée (X), ou bien sa valeur est-elle subjectivement attribuée et variable selon les contextes culturels et individuels (Y) ?