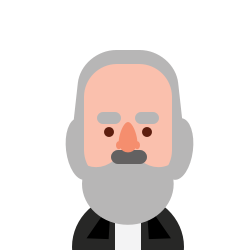# 0. Les notions
Ce sujet peut s'analyser à partir des notions 'nature' et 'travail'
# 1. **Explication du sujet** :
La question "Tout peut-il avoir une valeur marchande ?" interroge la possibilité de réduire l'ensemble des choses, êtres ou idées à leur dimension économique, c'est-à-dire à leur capacité à être échangés sur un marché. Cette interrogation soulève des enjeux éthiques, sociaux et philosophiques.
- Exemple 1 : **Platon**, dans la "République", distingue les besoins nécessaires des besoins superflus. Les premiers correspondent à des biens ayant une valeur intrinsèque pour la survie et le bien-être, tandis que les seconds sont sujets à la fluctuation des désirs et donc à la spéculation marchande. Cela montre que certains biens ne devraient pas être soumis à la valeur marchande.
- Exemple 2 : **Aristote** fait la distinction entre l'économique (oikonomikos) et la chrématistique dans "La Politique". L'économique est l'art de gérer la maison et se concentre sur l'utilité des biens, tandis que la chrématistique est l'art de l'acquisition et traite des biens comme des marchandises. Pour Aristote, la chrématistique n'a pas de limite naturelle, ce qui pose la question de la moralité de tout transformer en marchandise.
- Exemple 3 : **Karl Marx** critique dans "Le Capital" la marchandisation de la force de travail humaine. Il montre comment le capitalisme transforme les travailleurs en marchandises, réduisant leur valeur à celle d'un salaire. Cela illustre que la marchandisation peut déshumaniser et aliéner.
- Exemple 4 : **Georg Simmel**, dans "Philosophie de l'argent", analyse comment l'argent, en tant qu'intermédiaire universel, attribue une valeur marchande à presque tout. Cependant, il souligne aussi que certaines dimensions de la vie, comme les relations humaines authentiques, résistent à cette évaluation monétaire.
En conclusion, bien que le marché puisse attribuer une valeur à une grande variété d'objets et de services, la question philosophique demeure de savoir si cette valeur marchande doit ou peut s'étendre à tout. Les exemples philosophiques montrent que certaines choses, comme la dignité humaine ou la vérité, échappent à une telle évaluation et devraient peut-être rester hors du domaine marchand.
# 2. **Du sujet à la problématique** :
Pour passer du sujet à la problématique, il faut d'abord comprendre le sujet en profondeur, puis identifier et analyser les mots-clés, avant de formuler la question centrale qui guidera la réflexion. Voici les étapes détaillées :
- **Compréhension du sujet** : Il s'agit de saisir le sens général du sujet. Ici, le sujet interroge la possibilité d'attribuer une valeur marchande à tout.
- **Analyse des mots-clés** : On identifie les termes importants du sujet et on les définit pour clarifier leur sens.
- **Formulation de la problématique** : À partir de l'analyse, on formule une question qui soulève un problème philosophique à résoudre.
**Mots-clés** :
- **Tout** : Ce terme désigne l'ensemble des choses, sans exception.
- **Valeur marchande** : C'est le prix auquel un bien ou un service peut être vendu sur un marché.
**Repère philosophique** :
- **Vrai/probable/certain** : Ces distinctions aident à comprendre la nature de la valeur. La valeur marchande est-elle une vérité objective (certaine), ou est-elle sujette à des probabilités et des contextes (probable)?
**Conclusion partielle** :
La question implicite posée par le sujet est : Est-il justifié ou possible de réduire l'existence de toute chose à sa valeur économique ? Cette interrogation nous amène à réfléchir sur la nature de la valeur et sur les limites éthiques et pratiques de la marchandisation.
# 3. **La problématique** :
Le commerce peut-il attribuer une valeur à tout, ou bien existe-t-il des aspects de l'existence qui échappent intrinsèquement à la valorisation marchande ?